📚 Résumé :
Dans un premier article, nous présentions la préparation et les objectifs du parcours philosophique au Louvre pour nos élèves de Terminale.
Ils y ont découvert divers chefs-d’œuvre afin d’illustrer les notions étudiées en classe de philosophie.
Cliquez ici pour lire le premier article.
Dans ce second volet, nous revenons sur la synthèse qui a suivi la visite. Les élèves ont pu approfondir leurs réflexions en classe, échanger sur leurs impressions et comprendre comment l’art peut nourrir une approche philosophique plus vivante et concrète.
Introduction
Le 9 avril dernier, nos élèves de Terminale générale d’Ipécom Paris ont arpenté les galeries du Louvre pour un parcours philosophique inédit. Accompagnés par leurs enseignants, Rodolphe Fonty et Davina Chedembrum Bhooal, ils ont découvert plusieurs chefs-d’œuvre et se sont interrogés sur des questions essentielles : la beauté, le sacré, le pouvoir et la représentation de la mort.
De retour en classe, le professeur Fonty a proposé un moment de synthèse. Il a rappelé les points essentiels liés à chaque œuvre et leurs prolongements philosophiques. Voici un aperçu des « petites choses à retenir » de cette visite.


1. La Belle Ferronnière (Léonard de Vinci, c. 1490)
Beauté et perception
Cette peinture de Léonard de Vinci a suscité de nombreuses réactions. Certains élèves ont trouvé la figure féminine moins « belle » que ne le laissent supposer sa renommée ou les canons esthétiques actuels. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit d’un « beau » tableau.
Le professeur Fonty a alors cité Kant :
L’art n’est pas la représentation d’une belle chose, mais la belle représentation d’une chose.
En d’autres termes, la beauté peut varier selon l’époque, le contexte et la sensibilité de chacun. Ce qui compte, c’est la façon dont l’artiste parvient à sublimer un sujet pour en faire une œuvre captivante. La technique, le cadrage, la lumière et l’expression du modèle jouent ici un rôle majeur. Ainsi, « La Belle Ferronnière » illustre parfaitement la différence entre la beauté du sujet et la beauté de la représentation.
2. Pietà avec Saint François et Sainte Marie-Madeleine (Annibale Carracci, c. 1600)
L’art sacré et l’humanisme
Cette « Pietà » se trouvait à l’origine dans une église à Rome. Elle avait pour fonction d’offrir au peuple une représentation sensible de la souffrance du Christ et, plus largement, du sacré. À une époque où l’alphabétisation était loin d’être généralisée, l’art religieux jouait aussi un rôle d’enseignement et de transmission de la foi.
Ici, l’humanisme et le réalisme pictural rapprochent le divin de l’humain. Le Christ ne paraît plus distant et inaccessible. Au contraire, le tableau montre la douleur de Marie, l’émotion palpable de Saint-François et de Marie-Madeleine. Cette proximité émotionnelle a pour but de toucher les fidèles. Elle leur rappelle que la foi est avant tout une affaire d’empathie et de partage. Les stigmates visibles sur Saint-François soulignent cette identification profonde au Christ.
Pour les élèves, cette œuvre illustre la force pédagogique de l’art. Elle montre comment la religion peut se rendre tangible, presque palpable, grâce à l’émotion esthétique.


3. La Mort de Sardanapale (Eugène Delacroix, 1827)
La représentation de la mort et la sublimation artistique
Devant cette scène d’une grande violence, les élèves ont été frappés par l’intensité de la composition. Delacroix dépeint la fin tragique de Sardanapale, qui ordonne la destruction de tout ce qu’il possède pour ne rien laisser à l’ennemi. Hommes, femmes, objets précieux : tout doit disparaître dans un dernier élan de fureur.
Au-delà de la brutalité du sujet, le professeur Fonty a souligné la beauté picturale de la toile. Les couleurs, les mouvements et la théâtralité créent un sentiment paradoxal : on éprouve à la fois de l’horreur et de la fascination. L’art « ne reproduit pas le visible, il rend visible », disait Paul Klee. Le peintre ne se contente pas de montrer la mort ; il la transcende. Il pousse à réfléchir sur la fragilité de la vie, la folie du pouvoir et l’absurdité d’une destruction totale.
4. Le Sacre de Napoléon (Jacques-Louis David, 1805)
Art et pouvoir, ou la propagande en images
Dans cette gigantesque composition, Jacques-Louis David représente la cérémonie du sacre de Napoléon à Notre-Dame. Le tableau, magnifique sur le plan esthétique, est aussi porteur d’un message politique puissant. Napoléon y apparaît plus grand, plus jeune, et la présence de sa mère est ajoutée alors qu’elle n’assistait pas réellement à la scène.
Le professeur Fonty a interrogé les élèves : est-ce l’équivalent d’un photoreportage ? En réalité, c’est un récit officiel, voulu par le pouvoir, pour glorifier un empereur. Par ces retouches (taille, âge, personnages ajoutés), l’artiste met son talent au service d’une vision idéalisée.
On comprend alors que l’art peut servir de propagande ou de célébration d’un régime. Il ne s’agit plus seulement de représenter fidèlement un événement, mais de le sublimer pour façonner la mémoire collective. C’est une leçon importante pour les étudiants : savoir décrypter les images et comprendre leurs enjeux idéologiques.
5. Les Esclaves (Michel-Ange, 1 515)
Le néoplatonisme et la libération de l’âme
Ces sculptures inachevées de Michel-Ange étaient destinées au tombeau d’un pape. On y voit des corps qui semblent vouloir sortir de la pierre, se dégageant peu à peu du bloc de marbre brut. Pour comprendre ce choix esthétique, il faut revenir au néoplatonisme. Selon cette philosophie, l’âme est enfermée dans la matière et aspire à se libérer pour atteindre la perfection.
Michel-Ange, en tant que sculpteur, joue le rôle de démiurge (Le dieu créateur de l’univers, pour les platoniciens.) : il libère l’Idée de la pierre. Cette métaphore illustre la lutte entre l’esprit et la matière. Les élèves ont apprécié la puissance de ces formes à demi libérées, comme si elles étaient figées dans un effort éternel. Là encore, l’art dépasse la simple représentation. Il symbolise une quête spirituelle, une aspiration à dépasser les limites du monde matériel.
6. Le Candélabre Piranèse (Piranesi, 1 778)
Assemblage d’éléments et définition de l’œuvre d’art
Ce candélabre illustre la question de l’assemblage. Plusieurs fragments antiques (sphynx, têtes de bélier, feuilles d’acanthe, etc.) sont unis dans une même composition. Résultat : une œuvre hybride, à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire. Les élèves ont pu se demander : est-ce que réunir des éléments disparates suffit à créer une œuvre originale ?
Le professeur Fonty a souligné que ce candélabre ne se limite pas à un « bricolage ». Il y a une véritable intention artistique dans la façon de juxtaposer et de fusionner ces motifs. L’objet final, bien que non utilitaire, possède une cohérence et une beauté qui lui sont propres. C’est là tout l’enjeu du détournement : sublimer l’existant pour en faire quelque chose de neuf.
7. Alexandre et Diogène (Pierre Puget, 1671)
Autorité et liberté intérieure
Cette sculpture met en scène la rencontre entre Alexandre le Grand et Diogène, le philosophe cynique vivant dans la pauvreté. Alexandre, considéré comme l’homme le plus puissant du monde, propose à Diogène de satisfaire ses désirs. La réponse est célèbre :
« Ôte-toi de mon soleil. »
Par ces mots, Diogène rappelle que la liberté ne dépend ni de la richesse, ni du pouvoir. Elle est avant tout une attitude intérieure, une indépendance de pensée et d’âme. Dans la scène, on voit qu’au niveau moral, c’est Diogène qui « domine » Alexandre. Cette inversion des valeurs fait écho à la philosophie cynique. Elle interpelle encore aujourd’hui. Quel est le vrai pouvoir ? Celui de commander des armées ou celui de n’avoir besoin de rien ?
Les élèves ont beaucoup réfléchi à cette question. Ils ont vu comment l’art peut illustrer un paradoxe : un grand conquérant peut sembler minuscule face à la force d’un idéal philosophique.
Échanges en classe : un prolongement indispensable
Le professeur Fonty a consacré plusieurs heures à discuter de ces œuvres en salle de cours. Les élèves ont partagé leurs impressions, leurs incompréhensions, mais aussi leurs coups de cœur. Certains ont été marqués par la violence de « La Mort de Sardanapale ». D’autres ont préféré le calme solennel de la « Pietà » de Carracci. Tous ont cependant réalisé à quel point le contexte, la technique et les intentions de l’artiste influencent la lecture d’une œuvre.
Ce retour en classe a permis de faire le lien entre la visite et la préparation au baccalauréat. Les notions de beauté, de sacré, de pouvoir et de liberté rejoignent en effet les questions du programme de philosophie. Les élèves ont pu s’exercer à argumenter, à formuler des problématiques, à citer des auteurs et artistes tels que Kant ou Paul Klee. Ils ont compris que l’art ne se limite pas à un simple divertissement : c’est aussi un outil de réflexion, un miroir tendu sur notre propre condition.
Une aventure pédagogique au-delà du musée
Ce deuxième article illustre la continuité du parcours philosophique d’Ipécom Paris. La visite du Louvre ne s’est pas arrêtée aux couloirs du musée. Elle s’est prolongée en classe, dans les débats, les dissertations et les échanges. Les élèves ont ainsi développé leur esprit critique, leur sensibilité artistique et leur capacité à articuler des idées complexes.
Au-delà de l’échéance du baccalauréat, cet apprentissage nourrit leur curiosité. Il les prépare à la dissertation de philosophie et au Grand Oral, certes, mais aussi à la vie citoyenne, où comprendre les images et les discours est fondamental. En découvrant la peinture, la sculpture et l’architecture à travers le prisme philosophique, ils apprennent à décrypter les enjeux esthétiques et politiques.
Un souvenir précieux pour nos futurs bacheliers
La visite au Louvre restera probablement gravée dans la mémoire de nos Terminales. Chacun a pu mesurer la force expressive des grands maîtres. Chacun a pu percevoir la richesse d’un lieu qui concentre plusieurs siècles de génie créatif.
Grâce au travail en classe, ils ont également pris conscience que l’art, loin d’être un simple ornement, questionne en profondeur notre rapport au monde. La beauté, le sacré, la mort, le pouvoir, la liberté… Ces notions traversent les œuvres et touchent à l’essence même de notre humanité.
À Ipécom Paris, nous croyons en l’importance de cette approche concrète, vivante et exigeante. Nous remercions le professeur Fonty pour son engagement, ainsi que nos élèves pour leur curiosité et leur participation active.
Pour conclure, ce deuxième article témoigne de l’intérêt que suscite une sortie culturelle bien préparée et intelligemment exploitée. Le parcours philosophique au Louvre se poursuit dans les esprits et dans les discussions, bien après la visite. C’est ce que nous souhaitions : un prolongement durable, qui nourrisse à la fois la réflexion et l’enthousiasme.
Rendez-vous dans quelques semaines pour d’autres projets pédagogiques, qui continueront d’allier, savoir, découverte et plaisir de l’apprentissage. À Ipécom Paris, nous restons convaincus que l’éducation est un voyage, et que l’art en est l’une des étapes les plus enrichissantes.
Articles connexes

Sortie au Musée de l’Homme

Noël au collège Ipécom

Atelier Théâtre en Anglais

🐟 Dissection en SVT : Une Expérience Concrète pour nos 6e-5e

Remise des prix Démosthène 2025

Le tutorat

Visite au Louvre : le retour en classe et les réflexions philosophiques

Parcours philosophique au Louvre.

La frise littéraire chronologique de Ménnat

Remise de Prix du Concours de Poésie

L’importance du théâtre dans l’éducation des lycéens à Ipécom Paris

Concours de Poésie 2024 : L'Art du Verbe et de la Performance

Concours Démosthène

L'Enseignement et la Pratique du Théâtre

L’atelier

Love and Poetry: The “Cento” Competition

Le championnat
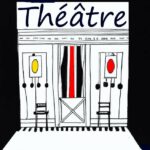
L'enseignement du théâtre

Voyage à travers le temps: La visite de la classe éclair (4e et 3e) au Musée de l’Homme

Atelier Radio : Parlons-en !

La Maison Henri Poincaré : Le musée qui rend les mathématiques fascinantes !

L'extraction de l'ADN de banane

Sortie éducative de la classe flash : Découverte de l'évolution des plantes

Le sport
Envie d’aller plus loin avec Ipécom Paris ?
Découvrez comment notre
lycée privé
prépare les élèves à la réussite et à l’épanouissement personnel.
Mis à jour le 14 Août 2025 à 17:33
Accès rapide
Tous les parcours Ipécom, du collège à la prépa.


